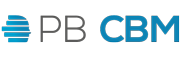Les premières assurances sociales mises en place dans les années 1930 reposaient sur un système de retraite par capitalisation. Le système de retraite actuel a été mis en place par le Conseil national de la Résistance à la fin de la seconde guerre mondiale (Ordonnances de 1945).
Le système s’appuie sur :
- Une solidarité intergénérationnelle entre actifs et retraités. Les actifs versent chaque mois des cotisations aux caisses de retraite qui les redistribuent aux retraités. Les cotisations étant considérées comme un salaire différé.
- Une solidarité fondée sur des critères socioprofessionnels au travers de plusieurs régimes (Régime général / mutualité sociale agricole (MSA) / régimes spéciaux / sécurité sociale des indépendants).
Il existe deux modes de fonctionnement :
- Le système contributif, dans lequel les pensions sont directement proportionnelles au montant total des cotisations versées par le salarié au cours de sa carrière professionnelle.
- Le système redistributif, dans lequel les pensions sont indépendantes du montant des cotisations versées. Le but est de permettre aux salariés les plus modestes de bénéficier de la solidarité des salariés aux revenus plus importants (périodes de perte involontaire d’emploi / maladie / chômage / …)
Quelques faits :
Le Danemark, la Finlande, la Suède), les Pays-Bas et le Royaume-Uni appliquent le modèle beveridgien (Il s’agit d’une redistribution verticale par l’État, financée par l’impôt, assurant des droits à tout le monde. Le taux de remplacement dépend de conditions (revenus, résidence, etc…) ce sont des fonds d’investissement qui gèrent les actifs.
L’Allemagne, l’Autriche comme la France appliquent le modèle bismarckien (solidarité horizontale entre les travailleurs, financée par des cotisations salariales et des cotisations patronales). le taux de remplacement dépend des cotisations et n’est soumis à aucune condition de ressources.
Évolution des effectifs et du rapport démographique selon les régimes
| Régime général (Source CNAV) | ||||
| Dates | 1975 | 2016 | 2021 | 2024 |
| Nombre de retraites en millions | 4,1 | 13,8 | 14,9 | 15,4 |
Montant mensuel moyen des retraites
| Régime général au 31/12/2022 (Source : CNAV Recueil statistique du régime général édition 2023) | ||||
Hommes | Femmes | Ensemble | Écart femmes / hommes | |
| Ensemble des retraités | 908 | 715 | 800 | – 21 % |
| Tous régimes au 31/12/2022 (Source : Les retraités et les retraites DREES 2024) | ||||
Hommes | Femmes | Ensemble | Écart femmes / hommes | |
| Pension brute de droit direct (Y compris majoration pour 3 enfants ou plus) | 2 050 | 1 268 | 1 626
| – 38 % |
L’essoufflement du système :
Depuis plus de soixante ans, le système français de retraite par répartition repose sur un principe simple et solidaire : les actifs financent, par leurs cotisations, les pensions des retraités. Ce modèle, institué à la Libération, a longtemps représenté un pilier de la cohésion sociale et de la solidarité intergénérationnelle. Il a permis d’assurer un niveau de vie correct aux retraités, tout en renforçant le contrat social entre générations.
Mais ce système, qui a fonctionné dans un contexte démographique et économique favorable — baby-boom, forte croissance, progression régulière des salaires — se trouve aujourd’hui sous tension. La combinaison du vieillissement démographique, de l’allongement de l’espérance de vie et d’une croissance économique moins dynamique fragilise durablement son équilibre.
Les réformes successives (1993, 2003, 2010, 2014, 2023) n’ont fait que repousser l’échéance. Les projections du Conseil d’orientation des retraites (COR) montrent que le système restera déficitaire dans les années à venir, malgré le relèvement progressif de l’âge légal de départ et l’allongement de la durée de cotisation.
Pour les employeurs, en particulier les directions des ressources humaines (DRH), les directions générales (DG) et les responsables rémunération, cette situation ne peut être ignorée. Les salariés, notamment les cadres et les jeunes générations, sont de plus en plus conscients que leur pension de retraite ne suffira pas à maintenir leur niveau de vie. Les entreprises ont donc un rôle crucial à jouer : proposer des dispositifs complémentaires permettant à leurs collaborateurs de préparer leur avenir, tout en renforçant leur attractivité et leur marque employeur.
Cet article propose une réflexion approfondie autour de trois grands axes :
- Pourquoi il ne faudra plus compter seulement sur le système de retraite par répartition actuel.
- Quels dispositifs peuvent être mis en place par les entreprises pour aider leurs salariés à compléter leur retraite.
- Quels sont les intérêts stratégiques pour les organisations de déployer de tels mécanismes, tant en matière de politique de rémunération que de gestion RH.
Pourquoi il ne faudra plus compter seulement sur le système de retraite par répartition
Un modèle historique fondé sur la solidarité intergénérationnelle
Le système de retraite français repose essentiellement sur la répartition : les cotisations sociales prélevées sur les salaires des actifs servent immédiatement à financer les pensions des retraités. Contrairement à un système par capitalisation, où chacun épargne pour sa propre retraite, la répartition repose sur la solidarité entre générations.
Ce modèle, instauré en 1945, répondait à un double objectif : protéger les personnes âgées de la pauvreté, et assurer un financement pérenne grâce à une population active nombreuse et à une croissance économique soutenue. Pendant plusieurs décennies, la mécanique a parfaitement fonctionné.
Dans les années 1960, on comptait près de 4 cotisants pour 1 retraité (source : INSEE). L’équilibre financier était donc facile à maintenir : les cotisations des actifs permettaient largement de financer les pensions, d’autant plus que l’espérance de vie à la retraite était encore limitée.
Le déséquilibre démographique : moins d’actifs, plus de retraités
Aujourd’hui, la situation est radicalement différente. Plusieurs facteurs ont fragilisé la répartition :
- La baisse du ratio cotisants/retraités. Selon le COR, il n’est plus que de 1,7 actif pour 1 retraité en 2023, et devrait continuer à se dégrader à l’horizon 2050, avec environ 1,3 actif pour 1 retraité.
- L’allongement de l’espérance de vie. En 1950, un homme qui atteignait 60 ans vivait en moyenne 15 années supplémentaires ; en 2023, il en vit plus de 23. Pour les femmes, la durée de retraite dépasse désormais 27 ans. Résultat : les pensions doivent être versées sur une période beaucoup plus longue.
- La stagnation de la natalité. Après le baby-boom des Trente Glorieuses, la France connaît une baisse de la fécondité (1,68 enfant par femme en 2023, contre 2,9 dans les années 1950). Cela réduit mécaniquement le nombre d’actifs futurs.
Ces évolutions démographiques exercent une pression considérable sur le système, qui doit financer davantage de pensions avec une base contributive relativement plus faible.
Les limites des réformes successives
Face à ce constat, les gouvernements successifs ont engagé de nombreuses réformes paramétriques :
- 1993 (réforme Balladur) : allongement de la durée de cotisation de 37,5 à 40 ans pour une retraite à taux plein, indexation des pensions sur les prix et non plus sur les salaires.
- 2003 (réforme Fillon) : alignement progressif du secteur public sur le privé, nouvelle extension de la durée de cotisation.
- 2010 (réforme Woerth) : report de l’âge légal de départ de 60 à 62 ans.
- 2014 (réforme Touraine) : allongement à 43 ans de la durée de cotisation pour les générations nées après 1973.
- 2023 (réforme Macron-Borne) : nouvel allongement, âge légal repoussé à 64 ans, durée de cotisation maintenue à 43 ans.
Ces ajustements ont permis de contenir temporairement les déficits, mais ils ne règlent pas le problème structurel. D’après le rapport du COR (septembre 2023), le système restera déficitaire sur la période 2025-2035, avec un besoin de financement compris entre 0,4 et 0,8 % du PIB par an, soit entre 10 et 20 milliards d’euros.
La baisse tendancielle du taux de remplacement
Au-delà de l’équilibre financier global, c’est surtout le niveau futur des pensions qui interpelle.
- Pour les générations parties à la retraite dans les années 1990, le taux de remplacement (rapport entre la pension et le dernier salaire) s’élevait en moyenne à 74 %.
- Selon le COR, ce taux devrait chuter à moins de 50 % pour les générations nées après 1990, en particulier pour les cadres supérieurs.
Cela signifie concrètement qu’un salarié qui gagne 4 000 € nets en fin de carrière ne pourra compter que sur une pension de 1 800 à 2 000 € environ, sauf dispositifs complémentaires.
Cette baisse relative du niveau de vie des retraités est déjà perceptible. En 2021, le revenu médian des retraités représentait 95 % de celui des actifs (source : INSEE). Mais selon les projections, ce ratio devrait tomber à 85 % d’ici 2040.
Une préoccupation croissante pour les salariés et les entreprises
Ces perspectives nourrissent une inquiétude légitime des salariés. Selon une enquête Ifop (2022), 72 % des Français estiment que leur retraite ne leur permettra pas de vivre correctement. Cette anxiété concerne particulièrement les jeunes générations, conscientes qu’elles devront travailler plus longtemps pour une pension plus faible.
Pour les entreprises, l’enjeu est double :
- répondre aux attentes de sécurité financière des collaborateurs,
- et intégrer la retraite supplémentaire dans une stratégie globale de rémunération et de fidélisation.
Les DRH, DG et responsables rémunération ne peuvent plus se contenter de s’appuyer sur le système public : ils doivent envisager et proposer des solutions de retraite complémentaire adaptées aux profils de leurs salariés.
Quels dispositifs les entreprises peuvent-elles mettre en place pour aider leurs salariés à préparer leur retraite ?
Face aux limites du système de retraite par répartition, les entreprises disposent de plusieurs leviers pour accompagner leurs collaborateurs dans la constitution d’une retraite supplémentaire. Ces dispositifs, qui combinent épargne individuelle et collective, peuvent prendre différentes formes juridiques et fiscales. Leur mise en place et leur gestion nécessitent un choix éclairé, car chaque solution comporte des avantages, des contraintes et des implications différentes pour l’employeur comme pour le salarié.
Parmi les principaux dispositifs disponibles, on distingue :
- le Plan d’Épargne Retraite individuel (PER individuel ou PERin),
- le Plan d’Épargne Retraite d’entreprise collectif (PERCOL, ex-PERCO),
- le Plan d’Épargne Retraite d’entreprise obligatoire (PERO, ex-Article 83),
- les régimes à prestations définies (nouvel Article 39),
- les régimes à cotisations définies non obligatoires (Article 82),
- et des dispositifs complémentaires (intéressement, participation, abondement employeur).
Le PER individuel (PERin)
Le PER individuel est une solution d’épargne retraite ouverte à titre personnel. Créé par la loi PACTE en 2019, il remplace les anciens contrats Madelin et PERP. Chaque salarié peut y souscrire indépendamment de son entreprise, mais celle-ci peut encourager son utilisation ou proposer un accompagnement.
Avantages :
- Souplesse : chaque salarié décide de ses versements volontaires et du rythme de son épargne.
- Avantages fiscaux : les versements sont déductibles du revenu imposable dans la limite d’un plafond.
- Portabilité : le PERin est conservé même en cas de changement d’employeur ou de situation professionnelle.
- Sortie possible en capital (en une fois ou fractionné) ou en rente viagère à la retraite.
Inconvénients :
- Dispositif individuel : l’entreprise n’est pas directement impliquée, ce qui limite son impact RH.
- Blocage des fonds jusqu’à la retraite (sauf cas de déblocage anticipé : achat de résidence principale, accident de la vie).
- Peu visible en termes de marque employeur s’il n’est pas associé à une politique d’accompagnement collective.
Le PER d’entreprise collectif (PERCOL)
Le PER d’entreprise collectif, qui remplace l’ancien PERCO, est un dispositif facultatif mis en place par l’employeur pour l’ensemble de ses salariés ou pour certaines catégories objectives. Il vise à constituer une épargne retraite collective, abondée par l’entreprise et alimentée par l’intéressement, la participation, l’abondement employeur et les versements volontaires.
Avantages :
- Dimension collective : permet d’impliquer l’ensemble des collaborateurs dans une logique d’épargne retraite.
- Fiscalité avantageuse : exonération de charges sociales sur l’abondement employeur (hors forfait social selon effectifs).
- Souplesse : possibilité pour les salariés de verser volontairement, avec un abondement de l’entreprise.
- Sortie possible en capital ou en rente.
Inconvénients :
- Gestion administrative à la charge de l’entreprise.
- Peut être perçu comme complexe par certains salariés.
- L’abondement doit être équitablement réparti, sans possibilité de ciblage individuel.
Caractéristiques des versements :
- Compartiment 1 – Versements volontaires.
- Compartiment 2 – Sommes issues de l’épargne salariale
- Possibilité d’un versement initial ou périodique de l’employeur
Sortie en capital :
- Uniquement pour les compartiments 1 et 2.
Imposition des cotisations :
- Choix 1 – Versements déductibles du revenu imposable.
- Choix 2 – Versements non déductibles du revenu imposable.
- Les versements issus de l’épargne salariale sont exonérés d’impôt sur le revenu.
Imposition des prestations :
- Rentes viagères à titre gratuit pour le choix 1
- Rentes viagères à titres onéreux pour les autres.
Le PER d’entreprise obligatoire (PERO, ex-Article 83)
Le PERO est un plan d’épargne retraite mis en place par l’entreprise pour une catégorie déterminée de salariés. Il prévoit des cotisations obligatoires versées par l’employeur, éventuellement complétées par les salariés. Ces sommes sont bloquées jusqu’à la retraite.
Avantages :
- Caractère obligatoire : permet d’assurer à tous les bénéficiaires une épargne retraite systématique.
- Déductibilité fiscale des cotisations.
- Outil efficace pour fidéliser certains profils, notamment les cadres et cadres dirigeants.
- Sortie possible en rente ou en capital (selon conditions).
Inconvénients :
- Moins de souplesse pour les salariés (versements obligatoires).
- Perception parfois négative de la part de ceux qui préfèreraient gérer librement leur épargne.
- Engagement financier durable pour l’employeur.
Caractéristiques des versements :
- Compartiment 1 – Versements volontaires.
- Compartiment 2 – Sommes issues de l’épargne salariale
- Compartiment 3 – Versements obligatoires du salarié et de l’employeur.
Sortie en capital :
- Uniquement pour les compartiments 1 et 2.
Imposition des cotisations :
- Choix 1 – Versements volontaires et obligatoires déductibles du revenu imposable.
- Choix 2 – Versements volontaires et obligatoires non déductibles du revenu imposable.
- Les versements issus de l’épargne salariale sont exonérés d’impôt sur le revenu.
Imposition des prestations :
- Rentes viagères à titre gratuit pour le choix 1.
- Rentes viagères à titres onéreux pour le choix 2.
Contrat relevant de l’article 83 du CGI
Caractéristiques des versements :
- Versements obligatoires en pourcentage du salaire et versés en tout ou partie par l’entreprise et le cas échéant en partie par le salarié.
- Depuis 2011, les versements peuvent aussi être effectués par le salarié à titre individuel et facultatif, en complément des versements obligatoires.
Sortie en capital :
- Non.
Imposition des cotisations :
- Les cotisations sont déductibles du salaire brut pour le salarié et du résultat imposable pour l’entreprise.
- Les versements volontaires sont déductibles du revenu imposable du foyer fiscal dans la même limite que celle du PERP.
Imposition des prestations :
- Rentes viagères à titre gratuit.
Les régimes à prestations définies (nouvel Article 39)
Le régime « Article 39 » vise à garantir un niveau de pension défini, exprimé en pourcentage du dernier salaire ou en montant fixe. Réservé historiquement aux cadres dirigeants, il a été réformé par la loi PACTE et est désormais soumis à des conditions strictes.
Depuis la réforme des retraites de 2010, les entreprises qui disposent d’un contrat relevant de l’article 39 du CGI sont dans l’obligation de mettre en place un produit d’épargne retraite supplémentaire collectif et obligatoire ou un Plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) pour l’ensemble de leurs salariés.
En 2015, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « loi Macron ») plafonne les droits acquis annuellement sur les contrats différentiels à droits aléatoires de type « retraites chapeau » à 3 % de la rémunération annuelle de référence servant au calcul de la rente9.
L’ordonnance n° 2019-697 du 27 novembre 2019 modifie la disposition de la loi de 2015 en plafonnant non seulement les droits cumulés annuellement à 3 % de la rémunération de la même année, mais aussi le cumul global des pourcentages annuels à 30 points tous employeurs confondus, quelles qu’aient été les rémunérations annuelles.
Avantages :
- Outil puissant de fidélisation des dirigeants et cadres stratégiques.
- Permet de sécuriser un niveau de pension significatif au-delà des régimes obligatoires.
- Signal fort envoyé aux talents clés sur la reconnaissance de leur contribution.
Inconvénients :
- Coût élevé pour l’entreprise.
- Régime encadré par une réglementation stricte et contraignante.
- Peut être critiqué socialement s’il n’est pas accompagné de dispositifs plus inclusifs pour l’ensemble des salariés.
- L’externalisation de la gestion financière des contrats relevant de l’article 39 est également devenue obligatoire pour les contrats ouverts depuis le 1er janvier 2010.
Caractéristiques des versements :
- Versements effectués uniquement par l’employeur.
Sortie en capital :
- Non.
Imposition des cotisations :
- Cotisations déductibles de l’IS de l’entreprise.
Imposition des prestations :
- Rentes viagères à titres onéreux.
Les régimes à cotisations définies non obligatoires (Article 82)
L’Article 82 correspond à des contrats souscrits par l’employeur au bénéfice de ses salariés, avec des cotisations volontaires. Les cotisations patronales sont considérées comme un complément de rémunération, soumis à charges sociales, mais non déductibles du revenu imposable du salarié.
Avantages :
- Grande souplesse pour l’entreprise et les salariés.
- Peut être utilisé comme outil complémentaire de rémunération différée.
- Convient particulièrement aux cadres dirigeants pour lesquels les plafonds de déduction des autres dispositifs sont atteints.
Inconvénients :
- Moins avantageux fiscalement que les PERO ou PERCOL.
- Complexité de communication auprès des salariés.
- Moins incitatif en l’absence de déduction fiscale à l’entrée.
Caractéristiques des versements :
- Versements obligatoires calculés en pourcentage du salaire, effectués uniquement par l’entreprise. Abondements libres du salarié possibles.
Sortie en capital :
- Oui.
Imposition des cotisations :
- Les cotisations sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu du salarié et déductibles du résultat imposable pour l’entreprise.
Imposition des prestations :
- Rentes viagères à titres onéreux
- Si sortie en capital : régime fiscal des contrats d’assurance-vie.
Les dispositifs périphériques : intéressement, participation, abondement
En complément des PER, l’entreprise peut mobiliser d’autres outils d’épargne salariale ayant un impact sur la préparation de la retraite :
- Intéressement : prime liée aux performances collectives de l’entreprise, exonérée de charges sociales (hors CSG-CRDS) et pouvant être versée sur un plan d’épargne.
- Participation : mécanisme obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus, redistribuant une partie des bénéfices et pouvant être affectée à un PEE ou un PER.
- Abondement employeur : contribution complémentaire de l’entreprise pour encourager l’épargne des salariés sur un plan dédié.
Ces dispositifs, bien qu’orientés initialement vers l’épargne salariale, participent également à la constitution d’une épargne de long terme mobilisable pour la retraite.
Il convient de noter que l’intéressement et la participation constituent des dispositifs générateurs de flux permettant aux bénéficiaires d’alimenter les plans d’épargne d’entreprise pour une épargne à moyen terme (épargne de précaution) ou à long terme (épargne retraite) ou pour augmenter le pouvoir d’achat (perception immédiate).
Au-delà de la mise en place obligatoire pour la participation, la différence fondamentale réside dans la possibilité, pour l’intéressement, d’inclure dans la formule de calcul des éléments financiers et/ou non financiers (RSE / qualité / satisfaction clients / ……) et ainsi d’intégrer et de faire partager avec les salariés, les objectifs et ambitions de l’entreprise.
Comparaison synthétique des dispositifs
Pour les DRH et dirigeants, il est essentiel de disposer d’une vision claire des options possibles. Voici un résumé :
| Dispositif | Bénéficiaires | Sortie | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|---|---|
| PER individuel (PERin) | Tout salarié (hors entreprise) | Capital ou rente | Souplesse, portabilité, fiscalité attractive | Dispositif individuel, blocage jusqu’à la retraite |
| PERCOL (ex-PERCO) | Tous les salariés ou catégories | Capital ou rente | Collectif, abondement employeur, fiscalité favorable | Gestion administrative, équité obligatoire |
| PERO (ex-Article 83) | Catégories définies | Capital ou rente | Obligatoire, fidélisation, défiscalisation | Moins souple, engagement durable de l’entreprise |
| Article 39 | Cadres dirigeants | Rente | Pension garantie, fidélisation forte | Coût élevé, réglementation stricte |
| Article 82 | Cadres et dirigeants | Capital ou rente | Souplesse, complément de rémunération | Moins favorable fiscalement |
En 2022, près de 18,5 milliards d’euros de cotisations ont été collectées dans le cadre de contrats de retraite supplémentaire, soit une diminution de près de 12 % en euros constants par rapport à 2021.
Celle-ci s’explique essentiellement par la baisse des versements sur les contrats à prestations définies et sur certains contrats individuels.
Le montant des prestations versées au titre de contrats de retraite supplémentaire augmente quant à lui légèrement en euros constants en 2022 et s’établit à 8,3 milliards d’euros.
La place de la retraite supplémentaire dans l’ensemble des régimes de retraite (légalement obligatoires ou non) demeure marginale. La part des cotisations versées à ce titre par rapport à l’ensemble des cotisations acquittées baisse à 5,1 % en 2022, tandis que les prestations servies sont stables et représentent 2,3 % de l’ensemble des prestations de retraite versées (Panorama retraites DREES 2024).
Les intérêts stratégiques pour les entreprises de mettre en place des dispositifs de retraite supplémentaire
Au-delà de l’aspect purement financier, la mise en place de dispositifs de retraite supplémentaire constitue un véritable levier stratégique pour les entreprises. Elle touche à des dimensions clés : attractivité, fidélisation, engagement, politique de rémunération et responsabilité sociale.
Un levier d’attractivité et de recrutement
Dans un contexte de guerre des talents, les entreprises doivent se différencier pour attirer les meilleurs profils. Les jeunes générations, mais aussi les cadres expérimentés, accordent une importance croissante à la sécurité financière et à la préparation de leur avenir. Proposer des dispositifs de retraite supplémentaire est perçu comme une preuve d’engagement de l’employeur envers ses collaborateurs.
Selon une étude Mercer (2023), 64 % des candidats considèrent les dispositifs d’épargne retraite comme un critère important dans le choix d’un employeur. Un PERCOL attractif ou un régime Article 83 bien conçu peut donc peser dans la décision d’un cadre hésitant entre deux offres d’emploi.
Un outil de fidélisation et de rétention des talents
La fidélisation est un enjeu majeur dans un marché de l’emploi tendu. Les dispositifs de retraite supplémentaire, en particulier ceux à cotisations obligatoires ou abondés par l’entreprise, incitent les collaborateurs à rester sur le long terme.
- Un PERCOL abondé chaque année crée un capital croissant qui encourage les salariés à rester pour en bénéficier pleinement.
- Un PERO (Article 83) ou un régime Article 39, en liant l’avantage à la durée de présence, constitue un puissant outil de rétention des cadres clés.
Les entreprises qui intègrent ces dispositifs dans leur package de rémunération réduisent leur turnover et sécurisent leurs compétences stratégiques.
Un élément différenciant dans la politique de rémunération
La rémunération ne se résume plus au salaire fixe et aux bonus annuels. Les salariés attendent une approche globale, incluant des éléments différés et sécurisants. Les dispositifs de retraite supplémentaire permettent de construire une politique de rémunération plus équilibrée, articulée autour de trois axes :
- Le court terme : salaire fixe, primes, avantages immédiats.
- Le moyen terme : intéressement, participation, PEE, avantages en nature.
- Le long terme : dispositifs de retraite supplémentaire (PERCOL, PERO, Article 39).
En intégrant la retraite supplémentaire, l’entreprise envoie un signal fort : elle ne se contente pas de récompenser la performance immédiate, mais s’inscrit dans une vision durable de la relation employeur-salarié.
Une réponse aux attentes intergénérationnelles
Les besoins varient selon les profils :
- Les jeunes salariés recherchent de la souplesse et de la transparence. Un PERCOL avec abondement, flexible et portable, répond à leurs attentes.
- Les cadres en milieu de carrière privilégient la constitution d’un capital retraite significatif. Les PERO et Article 82 sont adaptés.
- Les dirigeants et cadres supérieurs attendent des solutions sur mesure, comme l’Article 39 ou l’Article 82, permettant de compenser les limites des régimes obligatoires.
Une politique de retraite supplémentaire bien pensée doit donc être différenciée et adaptée aux différentes catégories de salariés.
Un levier de dialogue social et de responsabilité sociale
La mise en place d’un dispositif de retraite supplémentaire constitue un sujet de dialogue social constructif. Les représentants du personnel sont généralement favorables à des mécanismes qui renforcent la sécurité des salariés.
De plus, proposer une épargne retraite supplémentaire s’inscrit dans une démarche de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). Cela traduit un engagement concret en faveur du bien-être à long terme des collaborateurs, cohérent avec les attentes sociétales et les critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance).
Des avantages fiscaux et sociaux pour l’entreprise
Au-delà de l’aspect RH, les dispositifs d’épargne retraite présentent des avantages financiers pour l’employeur :
- Les abondements au PERCOL sont exonérés de cotisations sociales (hors forfait social, selon la taille de l’entreprise).
- Les cotisations patronales versées sur un PERO ou un Article 83 sont déductibles du résultat imposable.
- La mise en place de tels dispositifs peut réduire la pression sur les augmentations de salaires immédiates, en proposant des avantages différés mais perçus comme valorisants.
Cela permet de construire une stratégie de rémunération optimisée, équilibrant motivation des salariés et maîtrise des coûts pour l’entreprise.
Un alignement avec les tendances internationales
Dans de nombreux pays développés, les dispositifs de retraite par capitalisation complémentaire sont déjà largement répandus. Au Royaume-Uni, par exemple, l’« auto-enrolment » impose aux employeurs de proposer un plan de retraite complémentaire à leurs salariés. Aux États-Unis, les plans 401(k) constituent un pilier incontournable de la préparation à la retraite.
Les entreprises françaises qui mettent en place de tels dispositifs s’alignent ainsi sur les meilleures pratiques internationales, renforçant leur attractivité auprès des talents mobiles et sensibles à ces standards.
Conclusion
Le constat est clair : le système de retraite par répartition, tel qu’il fonctionne aujourd’hui, ne suffira pas à garantir un niveau de vie satisfaisant aux retraités de demain. Le déséquilibre démographique, l’allongement de l’espérance de vie et la baisse tendancielle du taux de remplacement rendent inévitable le développement de solutions complémentaires.
Pour les entreprises, l’enjeu dépasse la simple conformité ou la générosité : il s’agit d’un véritable levier stratégique. Mettre en place des dispositifs de retraite supplémentaire, c’est :
- répondre aux inquiétudes légitimes des salariés,
- renforcer l’attractivité et la fidélisation,
- moderniser la politique de rémunération,
- et affirmer sa responsabilité sociale.
Les options sont multiples : PER individuel, PERCOL, PERO, Article 39, Article 82… Chaque entreprise doit choisir en fonction de sa taille, de sa culture, de ses objectifs RH et financiers. Mais toutes ont intérêt à engager dès maintenant une réflexion sur ce sujet stratégique.
Dans un marché du travail compétitif et dans un contexte de défiance croissante vis-à-vis du système de retraite par répartition, les entreprises qui anticipent et agissent auront une longueur d’avance. Elles transformeront une contrainte sociétale en opportunité stratégique, en bâtissant une politique de rémunération à la fois performante, responsable et durable.
Besoin d’accompagnement ?
Face à la complexité croissante du système de retraite et à l’enjeu stratégique que représente la mise en place de dispositifs de retraite supplémentaire, il est essentiel de s’appuyer sur un partenaire expert et reconnu.
PEOPLE BASE CBM s’impose comme un acteur de référence sur le marché du conseil en rémunération et en stratégie RH. Fort de plusieurs décennies d’expérience et d’une expertise pointue en matière de politique de rémunération, de pesée des postes, de construction de grilles salariales et d’avantages sociaux, notre cabinet accompagne de nombreuses entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.
Notre approche repose sur trois piliers :
- Une expertise technique approfondie : nous maîtrisons l’ensemble des dispositifs d’épargne retraite (PER, PERCOL, PERO, Articles 39 et 82, etc.) et savons adapter leur mise en œuvre aux spécificités de chaque organisation.
- Une méthodologie éprouvée : nous combinons diagnostic précis, benchmark de marché et recommandations sur mesure pour bâtir des solutions fiables et performantes.
- Des outils innovants : grâce à notre logiciel WAAGE PRO, nous permettons aux entreprises d’analyser leurs pratiques, de simuler différents scénarios de mise en place et d’assurer un suivi efficace et conforme de leurs politiques de rémunération et de retraite.
Choisir PEOPLE BASE CBM, c’est bénéficier d’un partenaire capable de transformer une contrainte réglementaire et financière en véritable levier de performance, d’attractivité et de fidélisation.
Notre mission : vous aider à concevoir et déployer des solutions de retraite supplémentaire qui renforcent votre stratégie RH, tout en apportant à vos collaborateurs une sécurité et une visibilité accrues sur leur avenir.