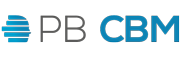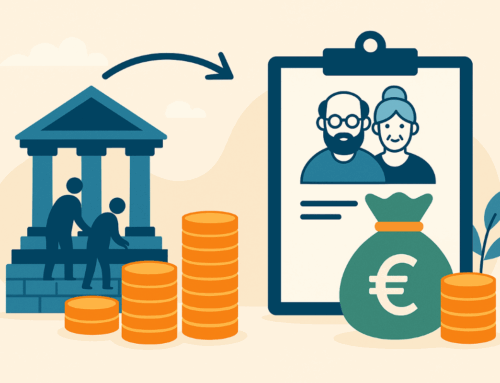Comprendre la Directive européenne sur la transparence et l’égalité des rémunérations
Les fondements historiques de l’égalité salariale
L’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas une préoccupation récente. Depuis la création de la Communauté économique européenne, les textes fondateurs affirment le principe d’égalité de rémunération. Cependant, ce principe est longtemps resté théorique, et son application concrète s’est heurtée à des résistances structurelles, à la complexité des pratiques salariales et à un manque de transparence généralisé.
Au fil des décennies, différentes initiatives ont été adoptées pour réduire les écarts : directives européennes, législations nationales, obligations de publication de données (comme l’Index de l’égalité professionnelle instauré en France en 2019). Pourtant, les inégalités persistent.
C’est ce constat qui a conduit l’Union européenne à adopter un cadre plus strict et contraignant, en plaçant la transparence salariale au cœur de la stratégie pour parvenir, enfin, à une véritable égalité de traitement.
Pourquoi une nouvelle directive était nécessaire
Plusieurs facteurs ont justifié l’adoption de la directive DETER :
- Un écart salarial persistant : malgré des politiques volontaristes, l’écart moyen de rémunération reste stable autour de 14 % en Europe.
- Une discrimination difficile à détecter : l’opacité des salaires empêche les salariés de comparer leur rémunération à celle de leurs collègues, et rend compliquée la détection des écarts injustifiés.
- Une pression sociétale accrue : mouvements sociaux, ONG et syndicats réclament depuis plusieurs années plus de transparence pour révéler et corriger les inégalités.
- Un besoin d’harmonisation européenne : chaque pays ayant adopté des dispositifs différents, la directive vise à créer un socle commun pour l’ensemble des États membres.
Ainsi, la DETER ne vient pas remplacer les dispositifs nationaux existants (comme l’Index égalité en France), mais les renforcer et les harmoniser au niveau européen.
Les principales obligations introduites
La directive impose plusieurs mesures structurantes, qui vont transformer en profondeur les pratiques RH, parmi lesquelles :
La transparence dès le recrutement
Les employeurs devront désormais indiquer les fourchettes salariales dans leurs offres d’emploi ou lors des entretiens de recrutement. Les candidats auront également le droit de connaître les critères de rémunération appliqués, afin d’éviter toute discrimination dès l’embauche.
Le droit individuel à l’information
Tout salarié pourra demander à son employeur des informations sur :
- son niveau de rémunération,
- la rémunération moyenne des collègues exerçant un emploi équivalent,
- et la répartition de ces rémunérations par sexe.
Cette transparence vise à donner aux salariés les moyens de détecter des situations discriminatoires.
Les rapports obligatoires sur les écarts de rémunération
Les entreprises de plus de 150 salariés devront produire régulièrement des rapports détaillant les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes :
- à partir de juin 2027 pour les entreprises de 150 salariés et plus,
- à partir de juin 2031 pour celles entre 100 et 149 salariés.
Ces rapports devront être annuels pour les entreprises de plus de 250 salariés, et triennaux pour celles de 150 à 249 salariés.
Les audits salariaux et l’évaluation conjointe
Lorsqu’un écart de rémunération d’au moins 5 % sera constaté et non justifié par des critères objectifs, l’entreprise devra réaliser, avec les représentants du personnel, une évaluation conjointe et proposer des mesures correctives.
La charge de la preuve inversée
En cas de contentieux pour discrimination salariale, ce ne sera plus au salarié de prouver l’existence de la discrimination, mais à l’employeur de démontrer l’absence d’inégalité.
Les sanctions renforcées
Les États membres devront prévoir des sanctions dissuasives en cas de non-conformité. Celles-ci pourront inclure des amendes proportionnelles à la masse salariale de l’entreprise, ainsi que la réparation intégrale du préjudice subi par le salarié (arriérés de salaire, primes, dommages et intérêts, etc.).
Le calendrier de mise en œuvre et la transposition en droit français
La directive a été adoptée le 10 mai 2023. Les États membres disposent de deux ans pour la transposer dans leur droit national, soit d’ici juin 2026 au plus tard.
En France, où un arsenal juridique existe déjà (notamment avec l’Index égalité professionnelle et les obligations issues de la loi Rixain), la transposition devrait s’opérer principalement par des ajustements législatifs et réglementaires. Cependant, plusieurs évolutions majeures sont attendues :
- élargissement du champ des informations à fournir,
- abaissement du seuil des entreprises concernées,
- introduction d’une charge de la preuve inversée,
- et sanctions financières potentiellement plus lourdes.
Les entreprises françaises doivent donc se préparer dès aujourd’hui, car les délais de mise en conformité seront courts une fois la transposition réalisée.

Directive européenne sur la transparence et l’égalité des rémunérations : une redéfinition de la rémunération
Une approche élargie et précise de la notion de rémunération
L’un des apports essentiels de la directive DETER réside dans la définition élargie de la rémunération. Celle-ci ne se limite pas au seul salaire de base, mais englobe désormais toutes les formes de contreparties financières et en nature versées par l’employeur au salarié.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la notion de « rémunération » couvre :
- le salaire fixe,
- les primes (ancienneté, performance, prime annuelle, etc.),
- les rémunérations variables,
- les heures supplémentaires,
- les indemnités (déplacements, repas, logement),
- les avantages en nature,
- les indemnités de licenciement ou de maladie,
- et même les pensions professionnelles.
Autrement dit, tout ce qu’un salarié perçoit en raison de son emploi doit être intégré dans le périmètre de l’égalité salariale.
Cette extension a deux conséquences majeures :
- Les entreprises devront cartographier et valoriser tous les éléments de rémunération, même ceux qui ne sont pas toujours visibles ou comptabilisés.
- La transparence exigée portera donc sur un spectre beaucoup plus large que le simple salaire de base, complexifiant le travail des services RH.
Les défis pour les entreprises françaises
En France, l’Index égalité professionnelle repose déjà sur des indicateurs de rémunération, mais il est limité à certains critères et à un périmètre de comparaison précis. La directive va plus loin : elle exige une vision globale de la rémunération et une ventilation systématique des données par sexe et par catégorie d’emploi comparable.
Cela implique pour les entreprises :
- de revoir leurs définitions internes de la rémunération,
- d’aligner leurs systèmes d’information RH (SIRH) pour collecter et agréger toutes les données pertinentes,
- de renforcer la fiabilité et la traçabilité des informations transmises aux salariés, aux représentants du personnel et aux autorités.
En pratique, beaucoup d’entreprises françaises devront réorganiser leur architecture de données RH et mettre à jour leurs classifications de emplois / postes pour être en mesure de répondre aux exigences de la directive.
Vers une homogénéisation européenne
Au-delà des contraintes techniques, la directive crée un cadre homogène à l’échelle européenne. Cela facilitera, à terme, les comparaisons entre pays et renforcera la cohérence des pratiques. Pour les entreprises multinationales, cette harmonisation représente une opportunité de mettre en place des politiques globales de rémunération, plutôt que de gérer une mosaïque de règles locales.
Les impacts organisationnels pour les RH de la Directive européenne sur la transparence et l’égalité des rémunérations
La directive ne se contente pas d’ajouter de nouvelles obligations : elle oblige les entreprises à repenser en profondeur leur organisation interne et leurs pratiques RH.
Révision des politiques de rémunération
La première conséquence est la nécessité de revoir les politiques salariales existantes. Les entreprises devront :
- définir des critères clairs, objectifs et non discriminatoires pour l’attribution des salaires,
- expliciter les règles de progression (embauches, promotions, augmentations individuelles et générales),
- et formaliser ces règles dans une grille salariale transparente et partagée.
En pratique, cela signifie qu’il ne sera plus possible de se reposer sur des pratiques implicites ou discrétionnaires. Les entreprises devront être capables de justifier chaque niveau de rémunération par rapport à des critères objectifs et vérifiables et aussi de les historiser !!!
La pesée des postes comme étape incontournable
La directive impose, de facto, la mise en place ou le renforcement d’un système de pesée des postes. En effet, pour comparer des rémunérations et identifier des écarts injustifiés, il faut d’abord disposer d’une classification fiable des emplois, basée sur des critères objectifs (responsabilités, compétences, niveau d’autonomie, contribution à l’entreprise, etc.).
Sans ce travail préalable, il est impossible de démontrer que deux salariés exercent un « travail de même valeur » et doivent donc être rémunérés équitablement.
C’est là que l’accompagnement de cabinets spécialisés comme PEOPLE BASE CBM prend toute son importance : la mise en place de systèmes de classification robustes et reconnus est un chantier complexe qui nécessite expertise et méthodologie.
Rôle accru des managers et des représentants du personnel
La directive prévoit explicitement l’implication des représentants du personnel dans plusieurs étapes clés, notamment lors des évaluations conjointes en cas d’écart de rémunération injustifié.
Cela suppose une redéfinition du dialogue social au sein des entreprises, avec :
- plus de transparence dans les échanges,
- un partage systématique des données,
- et une responsabilité accrue des représentants des salariés dans le suivi des écarts.
Les managers, de leur côté, devront être formés pour :
- comprendre les nouvelles règles,
- appliquer les critères objectifs définis par l’entreprise,
- et répondre aux questions des salariés sur leur rémunération.
La dimension formation et sensibilisation devient donc un enjeu central.
Conduite du changement et culture d’entreprise
La directive ne se limite pas à un ajustement technique. Elle implique une évolution culturelle dans la manière d’aborder la rémunération au sein des organisations.
Passer d’une culture de l’opacité à une culture de la transparence suppose :
- de préparer les managers et les équipes RH à répondre aux attentes accrues des salariés,
- d’accompagner les collaborateurs dans la compréhension des écarts qui subsistent (et qui peuvent être objectivement justifiés),
- et de mettre en place des actions de communication interne claires et régulières.
La réussite de cette transformation dépendra donc largement de la capacité des entreprises à gérer le changement organisationnel et à faire de la transparence salariale non pas une contrainte, mais une valeur partagée.
Les impacts financiers
Si la directive DETER poursuit un objectif social et éthique, ses conséquences financières pour les entreprises sont loin d’être négligeables. Les DRH et directions financières devront anticiper de nouvelles charges, directes comme indirectes.
Les coûts de mise en conformité
Mettre en place les nouvelles obligations de transparence et de reporting nécessitera des investissements initiaux parfois conséquents :
- Mise à jour des systèmes d’information RH (SIRH) afin d’intégrer la collecte, l’analyse et la publication de données salariales détaillées.
- Formation des équipes RH et des managers pour comprendre les obligations, appliquer les nouveaux critères et gérer les demandes individuelles d’information.
- Recours à des audits salariaux externes pour évaluer les écarts de rémunération et garantir l’objectivité des résultats.
- Renforcement du dialogue social, qui mobilisera du temps et des ressources, notamment en cas d’évaluation conjointe obligatoire.
Ces coûts peuvent sembler élevés à court terme, mais ils doivent être perçus comme des investissements nécessaires pour sécuriser la conformité légale et renforcer la crédibilité de l’entreprise.
Les ajustements salariaux et politiques de rattrapage
L’un des impacts les plus significatifs réside dans la correction des écarts de rémunération injustifiés.
En pratique, les entreprises devront parfois procéder à :
- des augmentations ciblées pour certaines catégories de salariés,
- la révision de systèmes de primes ou de bonus,
- la refonte des processus de révision salariale (gestion des augmentations annuelles de salaires),
- ou l’ajustement de certaines politiques d’avantages en nature.
Ces mesures, indispensables pour éviter des sanctions ou contentieux, peuvent générer des coûts immédiats importants. Pour certaines entreprises, notamment dans les secteurs où les écarts de rémunération sont historiquement élevés, l’impact budgétaire pourrait être considérable.
Les risques financiers liés aux sanctions
La directive prévoit des sanctions proportionnées, efficaces et dissuasives. Chaque État membre sera libre de définir son barème, mais il est probable que les amendes soient calculées en fonction :
- du chiffre d’affaires annuel brut,
- ou de la masse salariale totale de l’entreprise.
Au-delà des amendes, le risque financier vient surtout de la réparation intégrale des préjudices pour les salariés victimes de discrimination salariale. Les employeurs devront verser :
- les arriérés de salaires,
- les primes manquées,
- des indemnités pour préjudice moral,
- et des intérêts de retard.
Dans certains cas, les montants cumulés peuvent atteindre des sommes très élevées, d’autant plus si plusieurs salariés engagent des recours collectivement.
Une opportunité pour renforcer l’équité et la motivation
Si la directive représente une contrainte budgétaire, elle peut aussi être perçue comme une opportunité d’investissement dans le capital humain.
En corrigeant les écarts injustifiés, l’entreprise :
- améliore la motivation et l’engagement des salariés,
- réduit le turnover lié au sentiment d’iniquité,
- et renforce son attractivité auprès des candidats sensibles aux questions d’équité et de responsabilité sociale.
À moyen et long terme, ces bénéfices peuvent largement compenser les coûts initiaux. Les organisations qui prendront de l’avance et intégreront la transparence salariale dans leur culture gagneront en productivité et en image employeur
Les impacts juridiques
Au-delà des aspects financiers, la directive introduit des changements juridiques profonds qui vont transformer la relation employeur-salarié et multiplier les risques contentieux.
De nouvelles obligations légales
La transposition de la directive obligera les entreprises à :
- fournir systématiquement des informations salariales aux candidats et aux salariés,
- publier des rapports détaillés sur les écarts de rémunération,
- justifier les écarts constatés par des critères objectifs,
- coopérer avec les représentants du personnel lors des évaluations conjointes,
- et conserver une documentation exhaustive sur leurs pratiques de rémunération.
Ces obligations deviendront des standards légaux, et non plus de simples bonnes pratiques.
L’inversion de la charge de la preuve
C’est l’un des points les plus marquants : désormais, en cas de litige, c’est à l’employeur de démontrer qu’il n’y a pas eu discrimination salariale.
Concrètement, si un salarié apporte des éléments laissant supposer une inégalité, l’entreprise devra prouver que la différence de rémunération repose sur des critères objectifs, non sexistes et transparents.
Cette inversion bouleverse l’équilibre juridique traditionnel et expose les employeurs à une multiplication des actions en justice. Une solution simple et efficace consistera à développer un système objectif d’évaluation de chaque couple « collaborateur / poste ». La création de ce type de formule d’évaluation est une des grandes spécialités du cabinet PEOPLE BASE CBM. Le cabinet possède en effet une longue expérience et une forte expertise dans les dispositifs de pesée et de classification…
Les nouveaux droits des salariés
La directive confère aux salariés un droit individuel renforcé à l’information. Ils pourront :
- exiger par écrit des informations sur leur rémunération et celle de leurs collègues,
- s’appuyer sur ces données pour contester d’éventuelles discriminations,
- saisir la justice en cas de réponse insatisfaisante ou d’absence de réponse.
Les candidats à l’embauche bénéficient également de droits nouveaux, puisqu’ils devront avoir accès aux fourchettes de rémunération dès le processus de recrutement.
Recours et contentieux accrus
La combinaison de la transparence, de l’inversion de la charge de la preuve et du renforcement des droits individuels ouvre la voie à une augmentation potentielle des litiges liés à la rémunération.
Les employeurs devront se préparer à :
- recevoir et traiter davantage de demandes individuelles,
- gérer des procédures internes de contestation,
- et affronter, le cas échéant, des recours collectifs devant les tribunaux.
Ne pas anticiper ces évolutions pourrait exposer les entreprises à des risques réputationnels et financiers majeurs.
Audits et contrôles renforcés
Enfin, la directive prévoit que les autorités compétentes des États membres pourront réaliser des audits et inspections pour vérifier la conformité des entreprises. Les employeurs devront donc disposer en permanence de :
- données fiables et à jour,
- une documentation claire sur les critères de rémunération,
- et des preuves tangibles de leurs démarches correctives en cas d’écarts injustifiés.
Cela renforce la nécessité de mettre en place des processus de gestion solides et une traçabilité rigoureuse des décisions salariales.
Les impacts communicationnels et réputationnels
Au-delà des aspects juridiques et financiers, la directive aura un effet déterminant sur la communication interne et externe des entreprises. La transparence salariale devient en effet un sujet hautement sensible, qui peut affecter la cohésion interne autant que l’image de marque.
La communication interne : instaurer la confiance
L’un des premiers défis pour les directions RH sera de gérer les réactions des salariés face à une transparence accrue. Lorsque les fourchettes ou écarts de rémunération seront communiqués, il est probable que des tensions émergent : comparaisons entre collègues, sentiment d’iniquité, interrogations sur la légitimité de certains écarts.
Pour éviter ces crispations, les entreprises devront :
- mettre en place une communication pédagogique, expliquant les critères retenus pour déterminer les salaires ;
- anticiper les questions fréquentes et y répondre de manière claire et factuelle ;
- accompagner les managers dans leur rôle d’explication et de médiation ;
- insister sur le fait que certains écarts peuvent être justifiés (compétences rares, responsabilités accrues, ancienneté, performance).
Une communication interne proactive et structurée permettra de transformer la transparence en levier de confiance, plutôt qu’en source de conflit.
La communication externe : répondre aux attentes des parties prenantes
La transparence salariale ne concerne pas uniquement les salariés : elle devient un enjeu vis-à-vis des parties prenantes externes.
- Les candidats à l’embauche : de plus en plus attentifs à l’équité et à la clarté des politiques salariales, ils seront sensibles aux entreprises capables de publier des fourchettes réalistes et attractives.
- Les investisseurs et actionnaires : dans un contexte où les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) prennent de l’importance, la transparence salariale deviendra un indicateur clé d’éthique et de responsabilité sociale.
- Les clients et partenaires : une entreprise affichant son engagement en matière d’égalité salariale pourra renforcer son image de marque et valoriser son rôle sociétal.
À l’inverse, les entreprises qui tarderont à se mettre en conformité risquent d’être pointées du doigt et de subir une dégradation de leur réputation.
La gestion de la réputation : un enjeu stratégique
La directive oblige les entreprises à considérer la rémunération non plus seulement comme un levier interne, mais comme un élément de communication stratégique.
Une bonne gestion de la transparence salariale peut :
- renforcer la marque employeur en valorisant la culture d’équité ;
- améliorer l’attractivité et faciliter le recrutement de talents ;
- favoriser la fidélisation des salariés, sensibles à l’idée d’évoluer dans une organisation juste et inclusive.
À l’inverse, la révélation d’écarts non justifiés, ou une communication maladroite, peuvent nuire durablement à l’image et déclencher des polémiques internes et externes.
Les impacts sur les processus et outils RH
La mise en œuvre de la directive va également transformer en profondeur les processus RH et nécessiter l’adaptation, voire le renouvellement, de certains outils technologiques.
Les processus de recrutement
Le recrutement sera directement impacté, puisque la directive impose la publication des fourchettes salariales dans les offres d’emploi. Cela implique :
- de définir des fourchettes cohérentes et compétitives pour chaque poste ;
- de s’assurer que ces fourchettes sont alignées avec la grille interne ;
- d’harmoniser les pratiques entre recruteurs pour éviter les incohérences.
Cela pourrait également réduire les marges de négociation individuelle, ce qui impose de repenser les pratiques de gestion des candidatures.
Les processus d’évaluation et de gestion des carrières
La transparence salariale va obliger les entreprises à formaliser davantage leurs processus d’évaluation et de progression. Concrètement :
- les critères de performance devront être objectifs et mesurables,
- les décisions de promotion et d’augmentation devront être documentées et justifiables,
- les parcours de carrière devront être pensés en lien direct avec la politique de rémunération.
Les salariés auront ainsi une meilleure visibilité sur les conditions d’évolution, ce qui renforcera la nécessité de cohérence entre gestion des talents et politique salariale.
Les processus de reporting RH
Le reporting devient un axe central de la directive. Les entreprises devront être en mesure de produire, selon leur taille, des rapports annuels ou triennaux sur les écarts de rémunération. Ces rapports devront :
- intégrer des données fiables et actualisées,
- analyser les causes des écarts constatés,
- et proposer des mesures correctives si nécessaire.
Cela nécessite une capacité analytique renforcée et l’adoption d’outils RH adaptés.
L’adaptation des outils informatiques
Les SIRH et logiciels de paie devront évoluer pour répondre aux exigences de la directive. Les fonctionnalités indispensables incluront :
- la collecte automatisée des données de rémunération,
- l’analyse statistique des écarts par sexe et par catégorie,
- la génération de rapports conformes aux obligations légales,
- et la possibilité de mettre ces informations à disposition des salariés et des représentants du personnel.
De plus, certaines entreprises devront se doter d’outils spécifiques pour la pesée des postes et la gestion des grilles salariales.
Des solutions comme WAAGE PRO, déjà utilisées par de nombreuses organisations, apportent une réponse concrète en permettant :
- la pesée objective des emplois,
- l’analyse des écarts de rémunération,
- la simulation des coûts de rattrapage,
- la construction de grilles salariales conformes aux nouvelles exigences,
- La production de statistiques et d’états de reporting nécessaires aux salariés mais aussi au respect des obligations légales des employeurs.
Une intégration transversale dans l’ensemble des processus RH
En définitive, la directive impose une logique d’intégration : la rémunération ne peut plus être gérée de manière isolée, mais doit être pensée comme un fil conducteur reliant recrutement, évaluation, développement des compétences, reporting et dialogue social.
Les entreprises qui réussiront cette intégration gagneront en cohérence et en efficacité, tandis que celles qui s’en tiendront à des ajustements ponctuels risquent de subir une complexité croissante et des tensions internes.

Comment se préparer ? Les chantiers prioritaires
La directive DETER ne laisse que peu de temps aux entreprises : la transposition en droit français interviendra d’ici juin 2026, et les premières obligations de reporting s’appliqueront dès 2027 pour les organisations de plus de 150 salariés. Pour être prêtes, les DRH doivent dès aujourd’hui engager une série de chantiers structurants.
Réaliser un audit des pratiques actuelles de rémunération
Première étape incontournable : établir un état des lieux précis. Cela suppose de :
- collecter toutes les données de rémunération (fixes, variables, avantages en nature, indemnités, etc.),
- analyser les écarts par sexe, catégorie d’emploi et niveau hiérarchique,
- identifier les éventuelles zones d’opacité ou d’iniquité.
Cet audit constitue la base de toute démarche de mise en conformité.
Pour ce faire, rien de plus simple avec la solution professionnelle WAAGE PRO : en savoir plus sur le logiciel de gestion des rémunérations
Mettre en place un système de pesée objective des postes
Sans classification claire et objective, il est impossible de comparer équitablement les rémunérations. Les entreprises doivent donc :
- définir des critères neutres et transparents (responsabilités, compétences, autonomie, complexité, impact),
- construire une grille de classification robuste,
- et s’assurer que chaque poste est correctement évalué.
Construire ou réviser la grille interne des rémunérations
Une fois les emplois pesés, l’entreprise doit bâtir une grille salariale alignée avec sa stratégie RH. Cette grille doit préciser :
- les minima et maxima par niveau ou famille de postes,
- les règles de progression (embauche, mobilité, promotions),
- les critères d’augmentation individuelle et collective.
Identifier et planifier les mesures de correction
Si des écarts injustifiés apparaissent, il faudra prévoir des plans de rattrapage. Cela implique :
- d’évaluer le coût financier des corrections,
- de planifier leur mise en œuvre sur plusieurs exercices budgétaires,
- de communiquer de manière transparente sur ces mesures.
Définir de nouveaux processus internes
La directive oblige à revoir en profondeur plusieurs processus RH :
- recrutement (publication des fourchettes salariales),
- gestion des carrières et promotions (critères objectifs),
- évaluation de la performance (indicateurs mesurables et traçables),
- reporting RH (production régulière de rapports conformes),
- révision salariale (augmentations de salaires).
Renforcer la communication et le dialogue social
Les représentants du personnel jouent un rôle central dans le suivi des écarts. Leur implication doit être anticipée :
- partage des données,
- participation aux évaluations conjointes,
- co-construction des plans d’action.
La communication interne devra également être repensée pour accompagner les salariés dans la compréhension des écarts et des mesures correctives.
S’appuyer sur des outils performants
Enfin, la mise en conformité nécessite des outils capables de :
- collecter et traiter les données salariales,
- identifier les écarts et simuler les corrections,
- générer automatiquement les rapports exigés.
Des solutions comme WAAGE PRO offrent déjà ces fonctionnalités et peuvent accélérer la transition.
Pourquoi se faire accompagner ?
La mise en œuvre de la directive est un chantier complexe, qui combine des dimensions juridiques, techniques, organisationnelles et humaines. Pour beaucoup d’entreprises, il sera difficile d’avancer seules.
La complexité des enjeux
Les défis à relever sont multiples :
- harmoniser des données disparates,
- assurer la fiabilité et la traçabilité des informations,
- redéfinir des processus RH sensibles,
- gérer les relations sociales dans un climat de transparence accrue,
- anticiper les coûts financiers et sécuriser les décisions juridiques.
Une approche uniquement interne risque d’être insuffisante.
L’apport d’un cabinet spécialisé
Faire appel à un cabinet expert comme PEOPLE BASE CBM permet de :
- bénéficier d’une méthodologie éprouvée pour la pesée des postes et la construction de grilles salariales,
- accéder à un benchmarking précis grâce à une base de données couvrant plusieurs centaines de métiers,
- disposer d’un regard extérieur neutre et objectif, essentiel pour instaurer la confiance avec les représentants du personnel,
- être accompagné dans le pilotage global du projet, de l’audit initial à la communication finale.
Des outils adaptés et éprouvés
En complément de l’expertise humaine, PEOPLE BASE CBM propose des solutions logicielles comme WAAGE PRO, qui facilitent la mise en conformité grâce à :
- l’analyse automatisée des rémunérations,
- la pesée non genrée des emplois,
- l’identification des écarts et la simulation des rattrapages,
- la production de tableaux de bord RH clairs et conformes.
Cette combinaison d’expertise conseil et d’outils technologiques représente un atout majeur pour réussir la transition.
Conclusion
La Directive européenne 2023/970 sur la transparence et l’égalité des rémunérations marque un tournant décisif dans la lutte contre les inégalités salariales en Europe. Plus qu’une simple évolution légale, elle impose une véritable transformation des politiques de rémunération, qui impactera l’ensemble des processus RH : recrutement, classification, gestion des carrières, reporting, communication interne et externe.
Si cette directive représente une contrainte importante, elle constitue aussi une opportunité stratégique. Les entreprises qui sauront anticiper et intégrer la transparence salariale dans leur culture en tireront des bénéfices considérables :
- une marque employeur renforcée,
- une meilleure attractivité auprès des talents,
- un climat social plus apaisé,
- et une réputation valorisée auprès des investisseurs et partenaires.
Mais pour atteindre ces résultats, il est indispensable d’engager sans tarder les chantiers prioritaires : audit, pesée des postes, construction de grilles, mise à jour des processus et des outils, formation des managers et communication interne.
Dans cette démarche, l’accompagnement par un cabinet spécialisé comme PEOPLE BASE CBM constitue une garantie de succès. Grâce à son expertise reconnue, à ses bases de données de rémunérations et à ses solutions logicielles innovantes, le cabinet aide les organisations à transformer cette obligation réglementaire en levier de performance et de responsabilité sociale.
En définitive, la transparence salariale ne doit pas être perçue comme une menace, mais comme une occasion de moderniser et d’humaniser la gestion des rémunérations. Les entreprises qui s’y engageront dès aujourd’hui prendront une longueur d’avance et contribueront activement à construire un marché du travail plus équitable, durable et attractif.
Besoin d’un accompagnement relatif à la Directive européenne sur la transparence et l’égalité des rémunérations ?
Prenez contact avec l’équipe People Base CBM pour échanger en toute confidentialité sur vos enjeux, vos objectifs et vos contraintes. Ensemble, construisons une politique de rémunération plus équitable, plus lisible et plus performante.