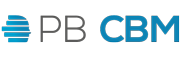Le plan d’épargne d’entreprise comporte les sources d’alimentation suivantes :
- Les versements volontaires (dont font partie l’intéressement, les droits monétisés provenant d’un CET, si l’accord le prévoit),
- Les transferts en provenance d’autres plans d’épargne salariale,
- Les versements complémentaires de l’employeur (abondement),
- La participation.
Les versements volontaires
Les versements volontaires annuels d’un adhérent aux PEE auxquels il participe ne peuvent excéder un plafond annuel global fixé à 25 % de sa rémunération. Le règlement du plan peut prévoir un montant minimum de versement.
Salariés et anciens salariés
La rémunération doit s’entendre de la rémunération brute qui est déclarée par l’employeur pour être soumise à l’impôt sur le revenu établi au nom du salarié, avant déduction des cotisations sociales et de toute déduction forfaitaire pour frais professionnels. La rémunération à prendre en compte est celle perçue au cours de l’année de versement.
Toutefois, le règlement du plan peut prévoir que la rémunération à prendre en compte est la rémunération annuelle à laquelle peut prétendre le salarié en début d’année civile en fonction de son contrat de travail et des conventions et accords collectifs applicables, sous réserve d’un ajustement à la hausse en cas de changements constatés en cours d’année. Cette disposition permet d’empêcher que les versements effectués soient remis en cause en cas de baisse de rémunération en cours d’année (maladie, suspension ou rupture du contrat de travail).
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, qui n’ont perçu aucune rémunération au titre de l’année de versement, le plafond de versement est égal au quart du plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les anciens salariés ayant quitté l’entreprise à l’occasion d’un départ en préretraite ou en retraite, le plafond de versement s’élève à 25 % de la somme des pensions perçues.
Sont notamment pris en compte pour l’appréciation du respect du plafond de versement :
- Les primes d’intéressement,
- Les actions attribuées gratuitement et versées sur un PEE,
- Les droits inscrits sur un compte épargne temps (CET) si l’accord du CET permet leur versement au PEE.
A l’inverse, ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du plafond :
- Le montant des droits des salariés inscrits sur un CET qui sont utilisés pour acquérir des titres de la société employeur ou d’une société qui lui est liée ou des parts de FCPE ou de SICAV d’actionnariat salarié (SICAVAS),
- Les actions issues de la levée d’options sur titre acquises au moyen des avoirs indisponibles du PEE.
Lorsque le salarié choisit d’affecter tout ou partie de sa prime d’intéressement au PEE, ce versement doit intervenir dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle les sommes ont été perçues. Lorsque le versement de l’intéressement au titre de la dernière période d’activité intervient après la rupture du contrat de travail, l’ancien salarié peut en affecter tout ou partie au PEE.
Lorsque l’accord d’intéressement prévoit le versement d’acomptes en cours d’exercice et que le montant des acomptes se révèle finalement supérieur au montant de l’intéressement, les versements effectués dans le PEE au-delà du montant définitif de l’intéressement ne peuvent être sortis du plan, mais ils perdent la nature d’intéressement tout en restant des versements volontaires. A ce titre, ils doivent être inclus dans l’assiette des cotisations sociales et déclarés à l’impôt sur le revenu comme complément de rémunération.
Il revient au salarié de veiller à ce que le montant annuel de ses versements n’excède pas 25 % de sa rémunération, ou de son revenu de substitution.
Lorsque l’adhérent souscrit à une formule d’actionnariat salarié dite à effet de levier, son versement (apport personnel) et l’impact du levier, notamment par un prêt bancaire ou l’équivalent en termes de contrat d’échange (swap), c’est-à-dire la souscription effective, doivent respecter cette limite de 25 % de la rémunération. Par exemple, un salarié ayant une rémunération de 40 000 € peut verser au PEE 10 000 € : si le levier est de 9 (le salarié verse 1, le prêt est de 9 pour une souscription totale de 10), l’apport personnel du salarié peut au plus être de 1 000 €, complété par un prêt de 9 000 €.
Dirigeants d’entreprise
Le plafond de versement est calculé en prenant en compte :
- Pour les mandataires sociaux (président, directeur général, gérant, membre du directoire), les rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans l’entreprise dont le montant est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires de l’année de versement (rémunération au titre du mandat social et jetons de présence spéciaux).
- Pour les chefs d’entreprise individuelle et les professionnels libéraux, le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité de l’année précédente, provenant de l’entreprise ayant mis en place le PEE. Cette deuxième solution s’applique également aux professions libérales exerçant leurs activités au moyen, par exemple, d’une SCM ou d’une SCP.
- Pour les conjoints collaborateurs ou associés de chef d’entreprise le quart du plafond annuel de la sécurité sociale.
- Pour les travailleurs non-salariés, le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
Le minimum éventuel susceptible d’être fixé par le règlement du PEE pour les versements des salariés et des autres bénéficiaires ne peut excéder la somme de 15 € par support de placement.
Ce versement minimum ne peut être opposé aux salariés qui souhaitent affecter au PEE tout ou partie de leur prime d’intéressement, conformément au droit reconnu aux bénéficiaires de l’intéressement de bénéficier d’une exonération fiscale lorsqu’ils investissent leur intéressement sur un plan d’épargne salariale.
L’abondement
L’aide de l’entreprise est obligatoire. Elle consiste en une prise en charge des frais liés au fonctionnement du plan, à laquelle peut s’ajouter un versement complémentaire conditionné par l’investissement du salarié.
Prise en charge des frais
Les PEE doivent comporter une aide apportée aux bénéficiaires par leur employeur en vue de faciliter la constitution à leur profit d’un portefeuille collectif de valeurs mobilières. Le règlement du plan d’épargne doit donc préciser les modalités de cette aide. Les prestations de tenue de compte-conservation sont obligatoirement prises en charge par l’entreprise. Ces prestations sont les suivantes :
- L’ouverture du compte du bénéficiaire,
- L’établissement et l’envoi des relevés d’opérations prises en charge par l’entreprise,
- Une modification annuelle de choix de placement,
- L’ensemble des rachats à l’échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas déblocages anticipés et à condition qu’ils soient effectués par virement sur le compte du salarié,
- L’accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.
La prise en charge par l’entreprise des éventuelles commissions de souscription (droits d’entrée) dans les fonds d’épargne salariale peut constituer l’aide minimale obligatoire de l’entreprise, en plus de la prise en charge des frais de tenue de comptes. Les prestations de tenue de compte conservation prises en charge par l’entreprise sont précisées dans une annexe au règlement du plan.
Les frais des opérations liées au fonctionnement du plan d’épargne qui sont applicables aux adhérents leurs sont adressés annuellement par l’entreprise ou, à la demande de celle-ci, par son prestataire, conformément aux dispositions prévues par la convention de tenue de compte. Ils sont également disponibles au travers des moyens télématiques mis, le cas échéant, à la disposition des salariés et/ou de tout autre moyen d’information.
Les commissions de souscription et de rachats et le taux de frais de fonctionnement et de gestion des OPCVM d’épargne salariale figurent dans les Document d’information clé pour l’investisseur (DICI) annexés au plan d’épargne.
En cas de dénonciation du dispositif d’épargne salariale, l’entreprise doit continuer à prendre en charge les frais de tenue de compte des bénéficiaires ayant des avoirs indisponibles dans ce dispositif d’épargne salariale.
En cas de liquidation de l’entreprise, les frais de tenue de compte dus postérieurement à la liquidation sont mis à la charge des bénéficiaires.
Le règlement du fonds, ou l’accord instituant le plan d’épargne salariale, peut prévoir que les frais de tenue de compte des anciens adhérents sont mis à leur charge par prélèvement sur leurs avoirs.
Le versement des sommes que l’entreprise attribue aux salariés au titre de la participation ne peut pas être considéré comme une aide fournie par l’entreprise.
L’abondement
L’aide de l’entreprise peut également consister dans des versements complémentaires. Ces versements, couramment dénommés abondement de l’employeur, sont strictement conditionnés aux versements des salariés eux-mêmes. Le règlement du plan peut prévoir une modulation de l’abondement que suivant des règles à caractère général.
La différenciation peut être liée à l’origine des sommes (intéressement), ou à leur affectation. Cette modulation peut avoir pour effet d’orienter l’épargne vers des instruments de placement privilégiés par le plan au regard de l’horizon de placement ou des titres éligibles (titres de l’entreprise, fonds solidaires ou éthiques).
Il n’y a pas lieu de proscrire, a priori, la modulation selon les catégories professionnelles ou encore selon l’ancienneté. Mais en aucun cas cette différenciation ne peut avoir pour effet en pratique de rendre le taux d’abondement croissant avec la rémunération.
Le salarié doit connaître au moment où il effectue son versement les modalités de l’abondement de son employeur. C’est pourquoi un avenant, conclu en fin d’année civile, qui préciserait le taux d’abondement applicable rétroactivement sur l’année, n’est pas recevable.
Le plafond de l’abondement est fonction du plafond annuel de la sécurité sociale. L’abondement versé au cours d’une année civile par une ou plusieurs entreprises ne peut excéder le triple de la contribution du bénéficiaire, ni être supérieur à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
En cas d’acquisition par le salarié de titres de son entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée, ce plafond peut être majoré de 80 %.
Le plafond d’abondement doit être apprécié par année civile. L’aide apportée par l’employeur aux bénéficiaires sous forme de prise en charge des prestations de tenue de compte-conservation, ne s’impute pas sur ces plafonds. Si un salarié a accès à plusieurs plans d’épargne salariale à cinq ans, le plafond d’abondement s’apprécie globalement.
L’affectation au plan d’épargne d’entreprise des droits à participation du salarié ouvre droit à l’abondement de l’entreprise.
L’abondement de l’entreprise doit être versé en même temps que le versement de l’adhérent ou au moins à la fin de chaque exercice civil. Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise avant que l’abondement auquel il a droit ait été versé, ce versement doit être effectué avant son départ.
Lorsque le PEE le prévoit et, selon les modalités qu’il détermine, l’abondement peut être versé sur un ou plusieurs autres supports de gestion que celui sur lequel le versement volontaire a été effectué. A défaut, l’abondement de l’entreprise sera versé dans le même support d’investissement que celui qui a été choisi par le salarié.
Le principe de non-substitution au salaire s’applique au versement complémentaire de l’entreprise.
Versement de la participation
Les salariés peuvent verser les sommes qui leur sont dues au titre de la participation financière dans le plan d’épargne d’entreprise. Tous les accords de participation, à l’exception de ceux mis en place dans les SCOP, doivent prévoir cette possibilité.
Lorsque le salarié a choisi d’investir sa participation dans le plan ou, en l’absence de choix de ce dernier, lorsque l’accord de participation prévoit l’investissement par défaut dans le plan, cet investissement doit se matérialiser dans les 15 jours à compter de la date à laquelle la participation est versée dans le plan par l’acquisition de parts de FCPE, SICAV ou de titres de l’entreprise.
Lorsque le versement de la participation au titre de la dernière période d’activité intervient après la rupture du contrat de travail, l’ancien salarié peut en affecter tout ou partie au PEE.
Dans les conditions prévues par le PEE et l’accord de participation, les avoirs détenus par les salariés peuvent être transférés de leur support de placement initial vers le plan d’épargne durant la période de blocage de 5 ans. Dans ce cas, la durée de blocage déjà courue pour les sommes en question s’impute sur la durée de blocage prévue par le plan d’épargne d’entreprise.
Les sommes transférées sans délai à l’issue de la période de blocage de la participation vers le PEE ne sont pas prises en compte dans le plafond de 25 %. Les sommes ainsi transférées ne peuvent donner lieu à abondement de l’entreprise. Elles ne sont pas bloquées.
Informations sur l’audit ou la mise en place d’un plan d’épargne entreprise (PEE)
Pour en savoir plus sur nos missions d’audit ou d’accompagnement à la mise en place d’un plan d’épargne entreprise (PEE), nous vous invitons à nous contacter directement au numéro indiqué ci-dessous ou via le formulaire de contact présent sur le site :